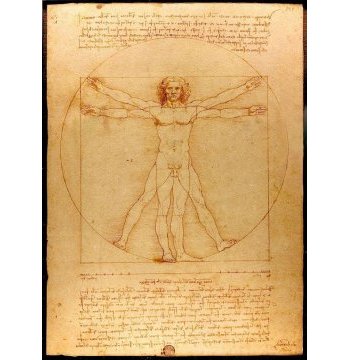Il y a 43 ans que le yoga est entré dans ma vie grâce à l’humble et lumineuse personne de Michel Alibert, rencontré un soir à la sortie d’un spectacle ; 43 ans qu’il est comme le levain qui fait lever la pâte, 43 ans que quelque chose qui était confus n’en finit pas de s’éclairer.
Le goût de la posture [1], m’est venu d’une sensation qui n’a cessé de se confirmer de devenir plus solide et plus souple et je ne parle pas du corps en disant cela. Or les deux qualités conjointes requises pour qu’un placement du corps soit une posture de yoga, sont la solidité et l’espace intérieur agréablement habitable qu’elle préserve. J’en ai donc très vite déduit qu’un système de vases communiquant existait entre la pratique du yoga et la vie.
Un mot m’a toujours accompagnée, celui de déconditionnement. Si j’ai toujours eu un farouche goût pour la liberté, j’ai été aidée par cette pratique, à prendre conscience de mes propres conditionnements. Si on y est attentif ils sont inscrits dans chacune de nos façons de faire, à commencer par celle des postures sur le tapis. Dès les premiers cours regarder en douce le voisin pour se rassurer, se forcer, s’efforcer de correspondre à une image que l’on suppose être la bonne, attendre d’être corrigé !
La pratique à laquelle j’ai été invitée par mes professeurs, Michel Alibert et Peter Hersnack, m’a permis de prendre conscience de beaucoup de ces attentes imaginaires et enfantines, et au fil des années de changer le curseur à partir duquel je réglais mes postures. Quand nous posions des questions, Michel Alibert nous répondait souvent « tu observeras ». Je suis souvent restée sur ma faim, car l’instrument de mesure manquait, mais avec le temps le langage du corps est devenu plus audible. Se développe une sensibilité perceptive à soi-même, puis la confiance dans ses propres ressentis et ses propres observations et enfin l’acceptation de se laisser guider par cela qui vient du dedans, au risque consenti de faire des erreurs et d’avoir à rectifier le tir.
Se détacher de l’image, et on n’en a jamais fini, n’est-ce pas cela le travail de déconditionnement que le yoga opère en nous, n’est-ce pas lui qui est libérateur ?
C’est comme un gant qui se retourne. Or l’intérieur du gant est le sens du gant, il est espace pour accueillir et abriter autre chose que lui-même, comme le sens de l’écorce est de protéger le tronc.
L’accès à cette vie intérieure, à commencer par ses aspects les plus tangibles – musculaires, articulaires, ouverts, fermés, sensibles, insensibles, organiques, circulatoires, respiratoires, nerveux etc.- accroît notre autonomie. On parle souvent de devenir plus conscient, je pense que la conscience et l’autonomie ont un rapport étroit, entre eux, et avec un troisième terme qui est l’authenticité. Parler en son nom, ne pas tricher avec soi-même, être à sa place, donnent une grande liberté dans l’action, et plus que cela, une action qui porte des fruits.
Mais cette confrontation de plus en plus fine avec le tapis ne va pas seule, il y a les mots du professeur qui prennent sens et les mots du Yoga sūtra dont la langue sanskrite permet à chacun, qui va le traduire dans la sienne, de choisir les mots qui ont du sens pour lui. Là encore les vases communiquent entre ces mots venus du dehors, les expériences de la pratique proprement dite et la vie toute entière, avec l’infinité de situations dans laquelle elle nous met. Ils infusent les uns dans les autres.
J’essaie de comprendre le Yoga sûtra depuis bientôt 40 ans, de le traduire, de le commenter, de le transmettre. Parfois certains passages sont lumineux, parfois obscurs comme au début. Je navigue dans ce clair-obscur, étrange alchimie entre un corps qui cherche et un texte qui parfois l’éclaire, entre des mots et des gestes. Avec le recul je dirais que quand il redevient obscur c’est que mon niveau d’exigence a changé. En faits, je ne le comprends pas. Il est obscur quand il reste abstrait.
C’est un traité lapidaire, en sanskrit d’il y a deux mille ans, enraciné dans une culture baignée de spiritualité, aide-mémoire à une transmission orale. Il donne une direction à l’aventure humaine mais on ne peut le prendre naïvement pour argent comptant. Il exige, à mes yeux, un énorme travail de traduction, transcription, questionnement et Il peut en être fait deux lectures différentes : une que j’appellerais savante, universitaire, disons de spécialistes de la culture indienne et de la langue sanskrite, qui ne pratiquent pas nécessairement le yoga. Et une lecture miroir pour celui qui s’aventure en lui-même. Comme le fait la posture, le texte le regarde et lui permet de se voir en temps réel et non de se perdre dans l’image. Ne peut-on parler d’une lecture iconique du texte ? Mais attention ! Il n’est miroir que de ce qui se révèle, de ce qui se produit. Sinon ce n’est que le texte devenu illusoire qui se réfléchit sur le miroir.
Pour l’ancienne étudiante en philosophie que je suis, Le Yoga sūtra tient sa force des balises qu’il pose sur le trajet. Il ne lâche jamais celui qui s’engage, avance dans un mouvement de spirale, où les obstacles de l’image reviennent sans cesse, mais à des niveaux et des endroits différents. Quand dans le texte les obstacles semblent résolus, le texte lui-même rappelle à celui qui avance que la vie, l’expérimentation, a un autre rythme, des freins, dont le dernier est bien encore l’orgueil d’avoir progressé et franchi des obstacles.
La balise principale, sur laquelle Michel Alibert revient sans cesse dans son enseignement, est la distinction, marquée par la structure même du texte, entre la pratique sous ses cinq premières formes - relation aux autres, à soi-même, discipline corporelle, énergétique et sensorielle – et les résultats – capacité d’attention, de méditation, de vide libérateur d’un esprit qui peut alors tout refléter comme le gant révèle la main, et l’écorce le tronc. Ceux-ci énoncés, dans le troisième chapitre, sont présentés comme un déploiement de nos capacités. Étant ainsi, il ne se commande pas, ne se pratique pas, mais advient ou pas et même quand il advient peut devenir un obstacle. La vie est ainsi comme un grand jeu de l’oie.
Pour moi, il y a là à nouveau l’écueil de l’image : celui de faire comme si on savait de quoi on parlait, comme si on avait acquis la capacité d’attention suffisante pour ces samadhi que décrit en tant d’étapes le texte ? Comme s’il était acquis que chacun à qui on s’adressait voulait arriver à cet endroit -là. Mais comme si, ça n’est pas comme ça. Comme si est du domaine du semblant, de l’illusoire, de l’image. Retour à la case départ.
Ne franchit-on pas parfois sans le dire la frontière entre une compréhension vécue du texte, dont on peut témoigner en son nom, et une compréhension savante de ce dont ont témoigné les anciens. A ne pas le dire, ne présupposons-nous pas que c’est aussi notre direction et celle aussi de chacun qui nous écoute ? Et ne perdons-nous pas de vue le principe même du yoga qui nous réunit de redonner à chacun l’occasion et la liberté de questionner et de nommer pour lui-même.
Alors que ce texte accompagne et nourrit ma vie je sens parfois qu’il peut aussi comporter une part d’illusion, qui serait d’en parler comme si on savait toujours de quoi on parlait. Cet esprit au repos, cette perception silencieuse, paisible, qui voit et entend l’essentiel des choses… qu’en avons-nous goûté véritablement ? C’était déjà ma question en 2009 [2], dans Cahier de Présence d’Esprit N°12, Le yoga un texte une pratique. Elle demeure.
Cet écueil de-mots-vidés-de-sens, je le retrouve aussi comme écueil possible comme gestes-vidés-de-sens dans les pratique posturale et respiratoire. Comme un bassin qui a été rempli se vide petit à petit par l’évaporation, les premières découvertes, les qualités acquises au fil du temps le perfectionnement du geste, comment ne pas les user, avec la répétition, comment ne pas finir par exécuter les postures ?
Finalement la question qui se pose à moi, et que je pose, est : comment éviter que l’étude du texte ni les pratiques, habitudes positives chèrement acquises, ne deviennent répétitives ? Habituelles dans le sens de : mécaniques. Comment faire pour que quelque chose se produise ?
Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est ma direction de travail. Revisiter les choses les plus simples, d’abord pour moi, pour pouvoir les comprendre puis les nommer différemment quand j’enseigne. Chercher sans cesse l’indication, le mot, en traduisant le texte ou en guidant des pratiques, qui va créer un petit déconditionnement, fracturer l’habitude, solliciter à nouveau l’attention, ramener au présent de l’expérience. Le langage, permet que quelque chose se produise quand il parle plus au cerveau droit qu’au cerveau gauche. C’est ainsi que je comprends le mot bhāvana. Un mot qui a le pouvoir de surprendre, de décaler, de dérouter très légèrement celui qui l’entend et de le faire juste un peu dévier de sa voie habituelle pour créer un fragment d’inattendu. C’est ce qui m’intéresse, ce petit moment de découverte et d’étonnement.
Et pour en revenir à ma question de départ, celle du conditionnement, comment faire pour que le yoga ne devienne pas un nouveau conditionnement, protégé par un mode de vie, d’alimentation, de manière de se soigner, de langage, et finalement d’appartenance à un groupe identitaire.
[1] Titre du documentaire sonore de qui accompagne le Cahier n° 13 de Présence d’Esprit.
[2] Cahier de Présence d’Esprit N°12.